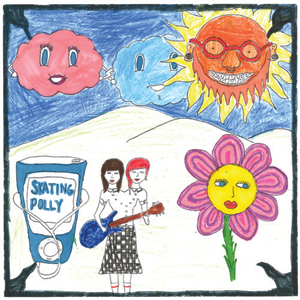Johnny Hawaii
Note : 7/10
Label : Hands In The Dark / La Station Radar
Année : 2013
Fort de ce premier disque aux sillons inondables, Johnny Hawaii perpétue l’été sur cinq plages de sable fin.
L’eau est partout. Elle coule dans les veines du Marseillais Olivier Scalia, alias Johnny Hawaii, et immerge les sillons de Southern Lights, son premier disque pressé en édition limitée à 300 exemplaires et qui semble être fait d’un alliage particulier à mémoire de forme. Ce matériau, c’est le vinyle qui semble se souvenir comme par bribes de l’unique point tangible entre ce qu’il y eut et ce qu’il y a.
La matière vinyle ressasse, en introduction, le roulement des vagues et la rythmique ici fantomatique et fantasmée d’un des premiers hits de la surf music : « Bustin’ Surfboard » des Tornadoes. C’est évidemment un clin d’œil assumé, et dès lors Southern Lights dévoile sa propre structure : cinq longues plages instrumentales qui débutent par « The Parrots Are Not What They Seem (They’re Just Pigeons On Acid) », en lice cette année pour le titre de morceau le plus hallucinogène.
« Driving Through the Jungle » lève les voiles et s’éloigne du littoral brumeux pour enfin oser s’aventurer au soleil, flânerie sonore dans une jungle aussi imprécise qu’avenante. Bien que, semble-t-il, aucun instrument synthétique n’ait été utilisé, « Canoeing Down a Quiet River » suggère les travaux ambients de Brian Eno, sur lesquels aurait été adjointe une batterie lancinante. De son côté, « Inner Beach » s’articule autour de deux syllabes incompréhensibles (On croit entendre “I won’t” mais rien n’est moins certain) et d’arpèges lumineux. Encore une fois, opacité et limpidité coexistent sans heurt. Enfin, « Psychic Suntan » baigne dans des eaux hautement psychédéliques, à croire que les plages marseillaises ressemblent à s’y méprendre à celles de la Californie.
Southern Lights fait partie de ces disques sentimentaux qui savent insuffler quelques points lumineux et bienveillants dans les vapeurs des réverbérations fuyantes. Johnny Hawaii possède l’art de manier les longueurs sans trop faire languir, l’art de laisser les mélodies s’épanouir sous les incessants ressacs, comme autant d’échos d’un passé altéré.
Chronique parue sur Bong Magazine