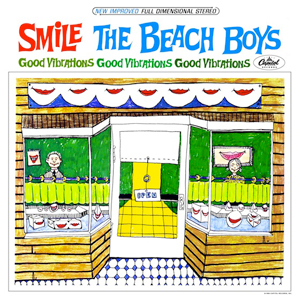Matthew E. White
Note : 9/10
Label : Domino
Année : 2013
Sorti au beau milieu de l’année dernière sur le label Hometapes, le premier album de Matthew E. White, Big Inner (malicieux jeu de mot avec « Beginner ») paraît ces jours-ci en Europe chez Domino Records. Dans une interview donnée à RVA Magazine en 2011 (ce qui confirme la justesse de cette théorie mise en pratique sur son album), White affirme être amoureux transi des grosses sections de cuivres et de cordes. Il déclare également vouloir calquer son processus d’enregistrement aussi bien sur le dub jamaïcain (pour ses expérimentations sonores) que sur la Motown, Stax ou Atlantic Records par l’omniprésence d’un house band, ce groupe résident qui participe exclusivement à l’enregistrement des tous les disques du labels.
De fait, dès la première écoute de Big Inner, l’abandon passionnel et rigoureux à ce postulat se révèle être tout à fait gagnant en termes de production et d’élégance sonore. Les arrangements sont subtilement boisés et cuivrés et les paroles baignent dans un lexique religieux et solennel. Une quasi-constance tout au long des sept morceaux qui composent un album où il est essentiellement question d’amour, de mort, des ténèbres et du paradis, mais aussi de grogs au whisky et du Brazos, le plus grand fleuve du Texas.
Au contraire de certaines des plus puissantes voix soul afro-américaines (James Carr, Wilson Pickett ou encore Lee Moses), Matthew E. White tisse sa foi sous des murmures et des violons mixés très loin en arrière-plan. Bien loin de tout maniérisme, White met du coeur à l’ouvrage pour offrir à son auditeur ses douces tempêtes musicales. Car au-delà de la très belle production de ce disque, c’est avant tout sa charpente mélodique qui laisse rapidement pantois. Big Inner n’est pas un concept album au sens communément entendu, mais il en possède tous les atours: des premières et infiniment douces mesures de l’inaugural « One of These Days » à « Brazos », cathartique cathédrale sonore d’une durée de 10 minutes, ce disque est gorgé de ballades savamment orchestrées (« Will You Love Me » ou « Gone Away ») et de brillants morceaux uptempo (« Big Love » et « Steady Pace »).
Héros soul à barbe du 21e siècle, Matthew E. White produit avec Big Inner une des plus belles orfèvreries que l’on ait pu écouter ces dernières années. Un album à ranger aux côtés de What’s Going On de Marvin Gaye pour la verve religieuse, de Nixon de Lambchop ou encore du premier album de Bill Fay pour la clairvoyance architecturale des arrangements. Big Inner inspire, expire et transpire une certaine majesté, ou plus exactement une richesse puisée dans les plus grandes heures de la musique soul, gospel et folk. Bref un disque totalement et éperdument américain.
Chronique parue sur Goûte Mes Disques