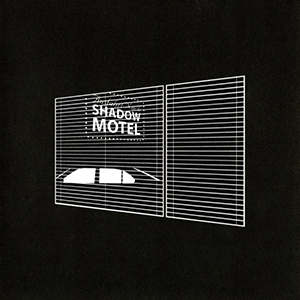John Carpenter
Note : 7/10
Label : Sacred Bones Records
Année : 2015
Hydre revêche et synthétique à neuf têtes, Lost Themes de John Carpenter associe le bon grain et l’ivraie.
Avant toutes choses, John Carpenter est le grand géniteur d’une filmographie dont certains segments sont des concentrés de terreur (The Thing, In the Mouth of Madness), d’angoisse latente (Halloween) ou d’ingénieux anthropomorphismes (The Fog). Et certaines de ses bandes originales, celles citées précédemment (à l’exception de The Thing, composée par le non moins impeccable Ennio Morricone) ainsi que celle d’Assault on Precinct 13, sont précisément de fantastiques mises en abyme sonores de l’obsession et du malaise inscrit sur la pellicule. Citons, pour illustrer ce propos, «Myer’s House» (Halloween) ou «Reel 9» (le sombre sommet de la B.O. de The Fog, qui est dans son intégralité le chef-d’oeuvre musical de Carpenter).
Après quatre décennies de compositions destinées à accompagner ses films, et à l’âge de 67 ans, John Carpenter fait paraître Lost Themes, véritablement son premier album puisque les morceaux qui le constituent sont des substances autonomes. Le maître lui-même l’annonce, en se remémorant les séances d’enregistrement du disque : “Aucun acteur ne me demandait ce qu’il devait faire, aucune équipe n’attendait, il n’y avait pas de salle de montage où aller. C’était juste du plaisir.” Ainsi, les morceaux ne se rattachent à aucune imagerie et fonctionnent en totale autarcie. Mélodiquement, Lost Themes est un bréviaire en neuf chapitres, un condensé de tout ce que Carpenter a écrit jusqu’à présent, et cela inclut le bon comme le moins bon. L’album débute par quelques accords de piano rapidement rattrapés par les rythmes et nappes artificielles. Un brin mélancolique, «Vortex» fait partie des morceaux les mieux maîtrisés.
Quant à lui, «Obsidian» fonctionne comme un court-métrage, développe sa narration à travers différents mouvements dont certains sont fâcheusement à la limite du mauvais goût, tel ce douteux mélange de batteries synthétiques et de guitares saturées qui donne cependant ce douceâtre charme suranné et cette nette impression de se retrouver pile au milieu des 80s. Mais comment en vouloir à Carpenter qui ne fait que tisser la trame sonore de nos propres cauchemars. Comment en vouloir à Carpenter de faire tout bonnement du Carpenter ?
Lost Themes est un hydre synthétique à neuf têtes, un album revêche qui pose les bases de la scénographie d’un film imaginaire, avec néanmoins une nette préférence pour quelques séquences telles que «Fallen», «Purgatory» ou «Night», où la rythmique s’efface ou n’est là que pour marquer le tempo, que pour signifier l’anéantissement du temps, afin de laisser place au spleen caractéristique des ouvrages les moins tempétueux de Carpenter.
Chronique parue sur Bong Magazine